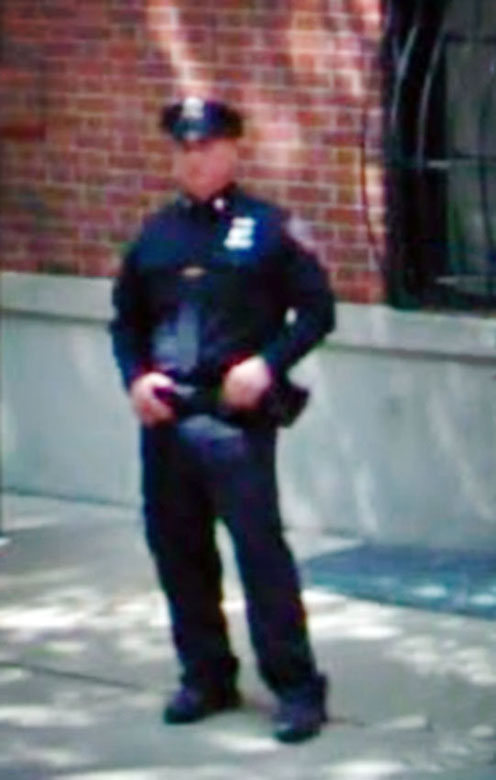



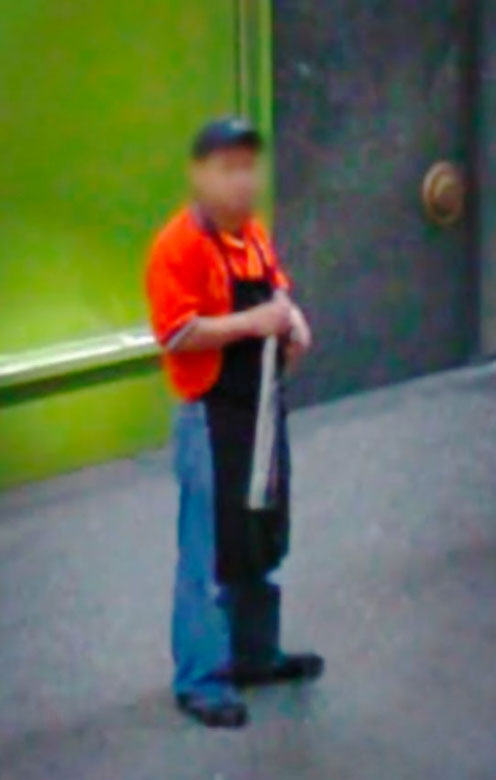




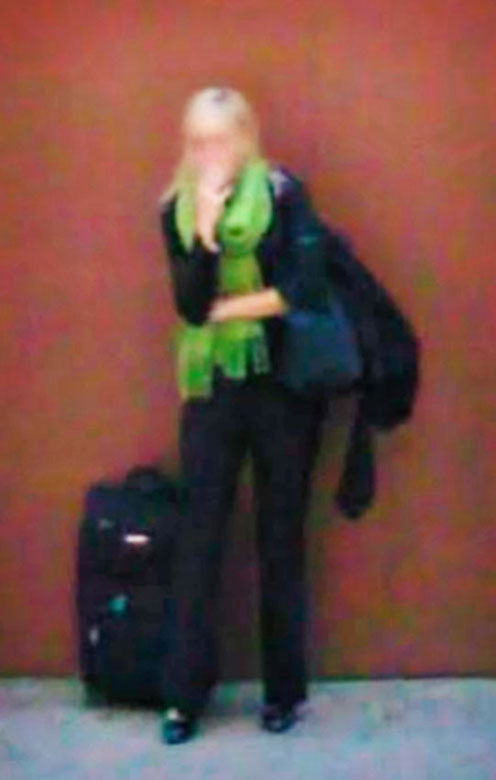


New-Yok mars 2011
Il y a quelques années, Patrick Fournial nous avait plongés, avec sa série “Parcelles“, dans le bain réjouissant des vacanciers tout à leur plaisir sur les plages de sable fin de son enfance. Il se jouait alors des lois de l’optique qui régissent généralement la perception que nous avons du réel à travers l’observation de photographies. Des mondes en miniatures surgissaient de cette perte de repère.
Aujourd’hui, l’enjeu semble ailleurs pour Patrick Fournial. Sa série “Parcelles” n’avait pu voir le jour que grâce à la “révolution numérique”. Cette nouvelle série n’existerait pas sans l’avènement de Google Street View en 2007.
De façon prémonitoire, en mai 2005, lors des Trans-Photographiques de Lille, le photographe français, Daniel Quesney, présentait “Neschers : méthodologie pour un état des lieux photographiques”, un travail effectué en 2003. Daniel Quesney, avait photographié l’ensemble des rues de ce village d’Auvergne, à l’aide d’un appareil monté sur un monopode qu’il déclenchait sans cadrer, tous les dix pas. Dans le catalogue de l’exposition, il expliquait : « La méthode repose sur l’exploitation et l’amplification du principe de captation d’indice du procédé photographique qui a pour qualité d’enregistrer toutes choses, sans hiérarchie, avec une acuité et une précision supérieure à la vision humaine ».
Mais remontons plus en arrière. A la fin du XIXème siècle, des millions de cartes postales sont éditées dans l’Europe entière. Elles représentent souvent des monuments historiques, des sites touristiques, des ouvrages de l’ère industrielle. Dans le bourg le plus reculé, la rue principale est systématiquement prise en enfilade. Les familles au grand complet posent sur le pas de la porte de leur maison. Même phénomène devant les manufactures et les ateliers. Il faut montrer à sa famille et à ses amis où l’on habite, les lieux qui nous enchantent. Ces cartes constituent aujourd’hui un formidable état des lieux sur lequel s’appuient de nombreux historiens.
En ce début de XXIème siècle, Google Street View effectue, à sa manière et non intentionnellement lui aussi, cet état des lieux selon la méthodologie rêvée par Daniel Quesney : plus d’opérateur pour venir brouiller le regard, juste une machine qui enregistre des vues, sans hiérarchie. L’acuité et la précision de la machine qui génère les images de Google Street View sont bien supérieures à la vision humaine : elle enregistre sur 360°. La flottille de ses engins parcourt les villes aux quatre coins de la planète. Le but n’est pas de dresser un état des lieux, mais de vendre de l’espace publicitaire aux communes, commerçants, entreprises et professions libérales. Si la machine enregistre ces milliards d’images, elle ne les trie pas pour autant. Elle les localise, mais ne donne aucune description, rien sur ce qui nous saute pourtant aux yeux lorsque nous observons une quelconque photo.
Tout à la fois séduit par le travail de Daniel Quesney mais recherchant encore et toujours l’image de ses semblables dans chacune de ses photos, Patrick Fournial décide de s’intéresser à l’outil “Google Street View” et de l’utiliser pour son travail de photographe. Ici, c’est le portraitiste qui s’exprime, dans la droite ligne de ses précédents travaux, et notamment de celui qui l’avait amené à parcourir les métropoles européennes au tournant du siècle dernier (Série Portraits d’Européens). Il choisit NY comme objet d’étude, ville symbole de la révolution numérique.
L’artiste est là pour réinventer le regard. Il détourne l’objet de sa fonction initiale et se l’approprie. Patrick Fournial recherche dans Google Street View l’image minimaliste des séries dans lesquelles il jouait avec les compressions et décompressions d’images. Il pensait créer ainsi une dynamique des pixels qu’il nomme “Pixodynamique”. De l’image initiale, il ne reste qu’un ensemble de carrés aux couleurs pastelles derrières lesquels se dessine l’essence même de la photo, l’essence d’un corps avec sa série “Plage“, d’un visage, “Masques“, ou d’objets, “Imagier“.
En 2001, avec sa série “Infinity”, l’artiste américain Bill Armstrong crée un ensemble de portraits, des images floues où l’on devine des expressions humaines : recueillement, écoute attentive… Il ne s’agissait que de simples papiers colorés froissés.
Patrick Fournial nous pose la même question que Bill Armstrong : Qu’est-ce qu’un portrait ? Jusqu’où une photo, aussi dégradée fut-elle, nous renvoie à une identification ? Certes, les images qu’offre Google Street View ne sont pas d’une grande qualité, mais est-ce si important ? Les visages sont volontairement floutés pour des questions de droits à l’image. On distingue à peine deux yeux et la forme d’un visage.
A l’heure où la technologie court après les pixels, Patrick Fournial nous montre, au fil des 76 images qui composent sa série, que cette course est parfois bien inutile. Il poursuit sa quête de l’homme du XXIème siècle. A l’instar de ses séries de portraits précédents, son regard semble s’être porté, une nouvelle fois, sur des modèles qui l’observent, sur des individus qui le touchent très certainement. Comment s’est opérée cette rencontre ? Quelles paroles ont-ils échangées ? Vertige océanique : rien n’a eu lieu. Tout ceci n’est que pures supputations !
Si Patrick Fournial pose la question du regard photographique, il ne parle pas pour autant de ce monde Orwellien. S’il poursuivra quelques temps cette exploration virtuelle, il est à parier qu’il retournera un jour à l’échange nécessaire photographe/modèle.
Sylvain Gérard – Galerie Aktinos

